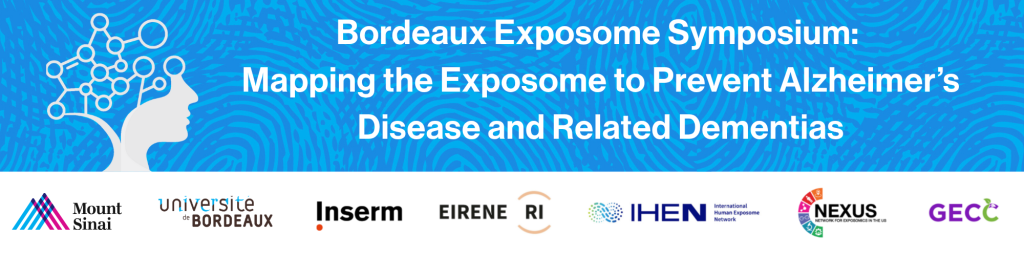Retour sur le 1er colloque et workshop du programme EXPOSOME de l’Inserm
Retour
C’est dans nos murs au BPH que se sont déroulées deux journées majeures consacrées au programme d’impulsion EXPOSOME de l’Inserm. Au cours de cette 1ere édition du 18 au 19 septembre 2025, de nombreux spécialistes de différentes disciplines se sont réunis et ont échangé autour du thème
« Inégalités sociales et exposome »

L’événement majeur 2025 du programme d’impulsion Exposome de l’Inserm a été ce colloque international « Inégalités sociales et Exposome » organisé à Bordeaux par l’Inserm avec le BPH et l’université de Bordeaux. L’occasion pour ce réseau interdisciplinaire d’exposomique de discuter des méthodes et approches déjà développées ou à venir, tout en renforçant les liens nationaux et internationaux au travers de projets collaboratifs.
Le BPH/UMR1219 a développé un axe fort de recherche sur l’exposome en santé publique, impliquant nombreux de ses chercheurs et des partenaires académiques. Les principaux projets structurants couvrent les dimensions méthodologiques, fondamentales et appliquées dans l’analyse des expositions environnementales et sociétales, et de leur impact en santé publique.
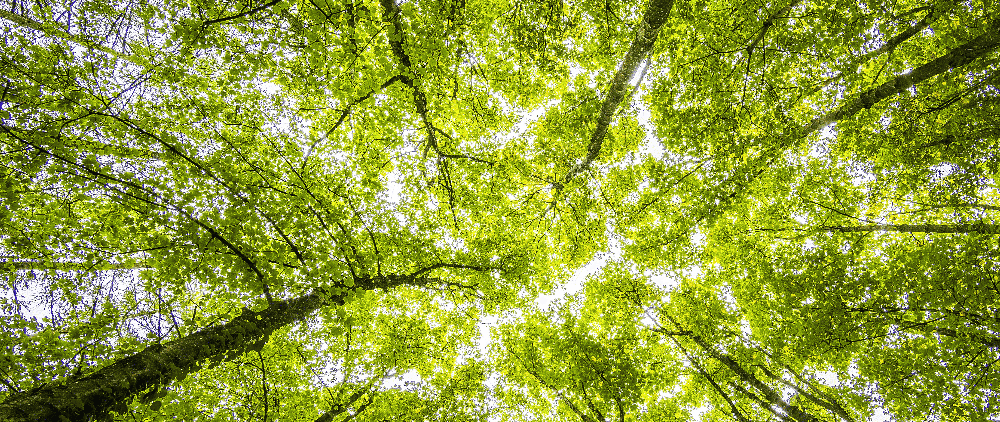
La notion« d’exposome » a été décrit en 2005 par Christopher Wild, et se définit par l’historique des expositions environnementales auxquelles un individu est confronté tout au long de sa vie, comprenant les expositions physiques extérieures, le contexte psychologique, social et les régulations du milieu intérieur au regard des différents stress et des effets à long terme ainsi que ceux potentiellement multigénérationnels
Ce concept d’exposome permet de mieux intégrer tous les liens entre environnement et santé comprenant l’ensemble des expositions environnementales auxquelles nous sommes confrontés tout a long de notre vie. Elle aide la communauté scientifique à décrypter dans son ensemble ces intrications complexes et aide à la modélisation de certains phénomènes.

C. Samieri
« Les expositions préoccupantes sont de multiples ordres » nous dit Cécilia Samieri, chercheure et co responsable de l’équipe ELEANOR-BPH.
« Depuis 20 ans, les facteurs de risque individuels, liés aux habitudes comportementales, sont davantage étudiés que les facteurs contextuels des communautés (accès à des espaces verts, pollution de l’air…) et les aspects sociaux. Il existe probablement de multiples modèles d’exposome, spécifiques à certaines pathologies ou situations » précise telle.
« L’exposome social est une composante importante de l’exposome, comprenant des facteurs primordiaux, c’est-à-dire initiaux, qui influencent de nombreuses autres expositions » selon Cécilia.
L’étude de l’exposome pourrait permettre aux scientifiques de démêler les vulnérabilités les plus importantes qui devraient être ciblées par les politiques de prévention.
Les populations précaires ont été identifiées comme les plus à risque face aux expositions préoccupantes. A côté de la vulnérabilité sociale qui est particulièrement prégnante il existe aussi des vulnérabilités biologiques qui sont étudiées aujourd’hui, comme par exemple le sexe féminin en lien avec un risque accru dans certaines pathologies comme la maladie d’Alzheimer, le terrain inflammatoire ou immunologique intrinsèque de l’individu, etc.

De gauche à droite : Quentin Clairon, Élodie Faure (CESP), Rodolphe Thiébaut
En marge de ce colloque s’est tenu le lendemain un atelier intitulé « Causal Inference in High-Dimensional Setting » organisé par Quentin Clairon, chercheur dans l’équipe BPH-SISTM.
Les discussions ont porté sur les nouvelles méthodes d’analyse visant à mieux exploiter ces données complexes.
En effet, l’analyse des expositions environnementales tout au long de la vie d’un individu nécessite des méthodes statistiques capables de gérer des données de grande dimension composées de mesures de natures différentes, reposant à la fois sur des facteurs à la fois chimiques, biologiques, physiques, sociaux… etc., souvent corrélés entre eux de manière complexe. Ces données sont recueillies sur de nombreux sujets et sont en constante évolution avec le temps nous dit Quentin Clairon.
Différents outils statistiques d’inférence permettent d’explorer et analyser les relations dans les données de recherche. Ces approches aident à mieux comprendre les mécanismes et facteurs étudiés, peuvent révéler des liens existants, aider à déterminer des relations de cause à effet, ou encore décrire l’évolution des phénomènes dans le temps.
Les différents outils statistiques qui ont été discutés reposent sur :
- l’apprentissage de réseaux d’exposition lorsque les mesures sont incomplètes ou difficiles à corréler
- la création de structures causales simplifiées adaptées aux données réellement disponibles
- l’estimation de modèles plus robustes face aux imprécisions des données de cohortes
- l’analyse de médiation dans le temps à partir de données recueillies à intervalles discrets
- le développement de modèles mécanistes capables de gérer un grand nombre de variables.
Par rapport à l’utilisation de l’IA dans les travaux, Il semble que des limites computationnelles et d’objectifs empêchent l’utilisation directe de ces outils selon Quentin Clairon.
Aujourd’hui il reste donc de nombreux défis, des enjeux éthiques et techniques à surmonter, et c’est tout ce réseau d’acteurs autour de l’EXPOSOME qui s’organise en vue d’accélérer les recherches qui pourraient permettre de mieux prévenir et d’agir sur les inégalités sociales en santé et les politiques publiques.
Les chercheurs sur l’exposome et santé du cerveau se retrouveront à Bordeaux du 17 au 19 juin 2026 lors du Symposium Bordeaux Exposome. Cette rencontre sera co-organisée par le BPH en collaboration avec le l’Institut thématique Santé publique (Inserm) et l’Institute for Exposomic Research, Icahn School of Medicine at Mount Sinai (États-Unis).
Plus d’information et inscription : https://mountsinaiexposomics.org/2026bordeaux/
Consultez l’article de l’Inserm Nouvelle-Aquitaine : Exposome : cartographie des expositions d’une vie – Inserm pro